L’être de Merleau-Ponty

Contenu complet
Notre propos portera sur deux aspects de la philosophie complexe et saisissante de Maurice Merleau-Ponty, une philosophie qui révolutionne la vision phénoménale et existentiale du monde.
Dans un premier temps nous parlerons du monde et de la façon dont nous l’habitons, ainsi que de la perception comme système de connaissance du monde. Dans un second temps, nous verrons que c’est par la communication que s’articule la perception de l’autre et la relation avec lui, nous verrons que l’être est une incarnation, qui tient le tout et nous possède.
Nous conclurons en argumentant sur le fait que l’être de Merleau-Ponty est un être pour le monde et pour autrui.
I. Le monde et la perception
a). Nous habitons le monde
La philosophie de Merleau-Ponty nous permet de comprendre que nous ne sommes pas de simples « être-là » au sens heideggerien du terme. Nous ne sommes pas qu’un « Dasein ». Pour le philosophe allemand nous sommes des « êtres au monde » alors que pour Merleau-Ponty nous sommes des êtres dans le monde, monde qui est déjà là, devant nous. Ce monde est ici soutenu par l’être qui ne demande qu’à exister en tant qu’être pour se laisser percevoir et percevoir le monde.
Nous sommes en relation avec ce dernier comme nous sommes en relation avec notre maison. Notre maison « est » notre maison, comme le monde « est » notre monde. Nous percevons notre maison comme notre maison et le monde comme notre monde car au fondement de tout ils « sont ». Nous sommes en relation avec ce qui nous entoure, car ce qui nous entoure « est ».
Nous ne sommes en relation que parce que l’être est là, il soutient le monde. Et l’être c’est une aperture, une ouverture au monde comme aurait pu dire Paul Ricoeur et d’après Merleau-Ponty, l’être est l’ouverture de la chair qui nous fait entrer en médiation avec le monde environnant. C’est là, la clef de notre perception, nous percevons ce qui « est ». Nous habitons le monde par notre chair et notre esprit, car nous sommes incarnation. Et c’est l’incarnation, qui nous fait habiter le monde. Car notre chair s’ouvre pour entrer en relation avec le monde et nous le faire habiter.
En effet, c’est notre être et son incarnation qui nous octroient le droit d’habiter le monde ; nous ne pouvons habiter que ce qui est. Nous habitons ce monde, comme nous habitons notre maison, dans les deux cas nous pouvons nous y mouvoir. Nous pouvons aller dans la rue, comme nous pouvons aller dans notre chambre.
Pour habiter pleinement le monde nous devons pouvoir le sentir. Nous devons pouvoir le toucher, le goûter, le sentir et surtout le voir. Nous sommes sommes chair, incarnation et de facto obligés de passer par la sensation et le mouvement pour percevoir le monde. Merleau-Ponty nous le rappelle effectivement, nous sommes des êtres sensori-moteurs. Nous habitons le monde grâce à un schéma corporel, ce schéma offre à mon corps un rapport intersoriel au monde qui m’entoure et me précède.
C’est ce phénomène qui fait quenous sommes au monde. Car le monde est une expérience de la sensation permanente. Si nous voulons nous convaincre que c’est par la perception que nous habitons le monde, observons les comportements primaires des enfants.
Le nourrisson ne porte-t-il pas tout à la bouche, comme pour goûter le monde ? C’est ici sa manière de s’approprier le monde, de l’habiter. Cependant, la vue reste la seule façon valable d’entrer en relation avec l’espace environnant. C’est par cette dernière, que notre être sort de nous, et se projette dans l’horizon de l’espace autour de nous. Assurément, c’est parce que je vois que je peux mettre du moi dans le monde. Aller voir, c’est beau d’aller voir, d’aller regarder. D’aller regarder ce qu’il y a derrière la grande palissade, pour qu’une fois vu, ce qui y est caché soit dévoilé et fasse partie de mon monde.
Par ce dévoilement, j’aurais découvert une nouvelle pièce dans ma maison-monde. Et c’est mon œil qui m’aura permis de voir ce qui est, et c’est par la perception de l’être omni tenens que nous entrons dans le monde et pouvons l’habiter.
b). La perception un système de connaissance du monde
Dans phénoménologie de la perception, à la page 235, Merleau-Ponty nous dit : « le corps propre et dans le monde comme le cœur dans l’organisme : il maintient continuellement en vie le spectacle visible, il l’anime et le nourrit intérieurement, il forme avec lui un système. »
Ici la métaphore du cœur est, au regard de sa pensée sur la chair, très intéressante.
En effet, la chair est ce que nous percevons des corps qui nous encerclent. C’est la masse que nous voyons et le cœur c’est justement ce que nous ne voyons pas. Le cœur rejoint là l’idée de foi perceptive qu’il défend.
Mais le cœur, c’est surtout le point de départ du système vasculaire, c’est lui qui donne l’impulsion. Le cœur, c’est l’être en nous. Il vascularise le monde, il lui donne l’impulsion qui le fait se projeter et percevoir le monde. La perception est une communication sensorielle entre le monde et moi.
Effectivement, grâce à cette dernière je peux naître avec le monde, je peux le connaître. Grâce à ma perception, je peux percer ce que je vois, voir ce qui est, et de facto le conceptualiser.
Je conceptualise ce que je vois, car ce que je vois me nourrit. Une fois vue, une carafe pourra être vue par l’imaginaire ; cette perception du dedans. Par ma vision de la carafe je me suis projeté en elle, et elle c’est projetée en moi. J’ai intériorisé sa forme, sa couleur, sa taille. Je l’ai vue dans un contexte, sur un fond qui me permet de l’identifier comme carafe. Elle était sur une table, au milieu de verres, elle était dans le jardin. Je l’ai vu depuis mon canapé. Ce qui est fabuleux, c’est que je peux la voir par l’imagination.
Mon esprit peut mettre en forme et en couleur la carafe qui n’est pas là, et je la vois intérieurement. Je la conçois car son corps est gravé en moi et du fait que je l’ai vue, je me suis gravé en elle.
Carafe dont on ne voit qu’une perspective dans l’horizon et qui soumise à un autre point de vue peut sembler plus petite, vermillon ou bien carmin selon l’exposition lumineuse. Mais aussi avoir une ance si elle est vue depuis le potager et non depuis le canapé, sur lequel je suis assis.
Le monde en effet est un spectacle où grâce à la perception, je deviens un spectateur acteur d’un système de relations de « corps à corps », de « chair à chair » mis en scène par l’être et possible par la perception. Ainsi je peux tisser un schéma de pensée et un schéma corporel qui m’ouvrent à un système de connaissance, octroyant à l’être une intentionnalité de l’existence.
II. Le rapport à autrui
a). La perception de l’autre est communication.
Notre rapport à l’autre, notre perception de l’autre, ne peut avoir lieu que parce que nous communiquons. L’être de l’autre est comme un miroir qui nous répond dès lors que l’on s’y projette. En effet, notre mode de perception d’autrui est forgé par la communication. Nous communiquons sans cesse, c’est cette communication qui rend possible l’intentionnalité de l’existence, et de facto notre perception de celui qui est en face de moi. La communication fait de moi un pour autrui.
Nonobstant, je perçois l’autre qui est un corps, une chair. Un corps qui n’est pas un corps en soi mais un corps pour soi qui sort de la pure objectivité pour être dans le pour soi, le pour autrui. Un corps qui est dans l’intersubjectivité. Il est pour la communication, ce qui implique tout le panel des sens, comme il est corps je peux le toucher, le sentir, l’ouïr et le voir. Les modes de communication sont le désir et la confiance. Communication elle-même mode d’existence de l’être.
A la question, « pourquoi je désire ma femme ? » Nous pouvons répondre, je la désire parce que je désire son corps, sa chair. Je veux pouvoir la toucher, la caresser, l’entendre, la voir. Je la désire car je désire la présence de son être dans mon espace. Je veux la voir exister dans mon champ de perceptions. Je veux qu’elle soit là. Je veux que mon être communique avec le sien. Mais, quand elle n’est plus là, je me retrouve dans un état de frustration car mon être ne peut plus se communiquer à elle, il ne peut plus communier avec elle. Et quand elle réapparaît devant moi, alors je ressens un sentiment extatique qui me fait à nouveau exister pour elle et la percevoir dans mon monde. Le désir est ici une intentionnalité dans le sens où je désire un corps qui existe, avec lequel je peux me communiquer à l’autre, à l’être de l’autre dans son incarnation, dans sa chair. Cependant, la communication à autrui, la communion des êtres, ne peut advenir que si la confiance, la foi perceptive est présente. La confiance peut s’observer dans un contexte cognitif et affectif.
Par exemple, ma mère. J’ai confiance en elle parce qu’elle est ma mère. Mère que je ne connais pas vraiment parce qu’elle relève du mystère pour moi. Je ne saurais jamais à cent pour cent qui elle est.
Sur le plan biologique c’est elle qui m’a conçu, d’un point de vue généalogique j’ai un lien de filiation avec elle et du point de vue de la quotidienneté elle est celle qui caressait ma joue et me faisait mes tartines le matin. En dehors de cette contextualité qui est-elle ? C’est pourquoi je ne peux avoir qu’une foi perceptive vis à vis d’elle, une expérience interrogative permanente. Quand j’étais petit, je m’étonnais qu’elle fasse des « trucs de grands ». Maintenant que je suis « grand » à mon tour, je m’interroge sur ses activités de « vieux ».
Quand je serais également « vieux » et qu’elle sera morte, je me poserais la question de savoir ce qu’aurait bien pu dire ou bien faire ma petite maman dans telle ou telle situation.
La foi perceptive ouvre la voie à cette interrogation perpétuelle, qui m’empêche d’enfermer ma mère dans un système de croyance, car si je l’y enferme alors elle n’est plus. Pour qu’opère le phénomène décrit ci-dessus il faut une osmose du corps et de l’âme afin de sortir de moi-même pour aller vers l’autre et entrer en relation avec lui.
Si ici, j’ai évoqué ma femme et ma mère, c’est parce que pour l’homme que je suis, la femme relève du mystère inépuisable et que comme disait Henri Wallon, je ne peux pas tout réduire en objet. Ma femme et ma mère sont ontologiquement autres et de facto elles échappent à mon intelligence. Ce n’est pas tant la question freudienne « que veulent-elles » qui anime ma relation à elles, mais plutôt la question « qui sont-elles ».
En effet, nous ne pouvons pas, par notre intelligence, y répondre car la question de leur être relève de leur infrastructure, de leur « ultra-chose » que je ne connais pas et qui restera mystérieux pour moi.
Enfin, c’est le mystère de l’être qui anime mon désir, qui est en réalité un besoin de rencontre et de communication avec l’autre, bien plus qu’une pulsion qui chez Freud et chez Sartre s’avère être de l’ordre de l’atavisme ou de la perversion. En fait, je désire et j’ai confiance car je veux comprendre l’autre et que l’autre me comprenne. Par la communication de mon être, je désire pouvoir être. Ce faisant je désire que l’on m’autorise à être.
b). L’être nous possède car il est incarnation
Chez Merleau-Ponty l’être est omni tenens, c’est-à-dire qu’il tient le tout, qu’il nous soutient. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas le posséder, mais que c’est lui qui nous possède. C’est l’être de l’homme, qui par l’union de l’âme et de la chair fait de nous des incarnations ; faisant ainsi de l’être merleau-pontyen une concrétude de l’être alors qu’à contrario de l’être cartésien, qui de part le « cogito » demeure une abstraction. La définition de Descartes « je pense donc je suis » réduit l’être à une pensée, une abstraction.
Alors que, chez Merleau-Ponty, l’être pourrait se définir par l’apophtegme suivant : « je m’incarne donc je suis » renvoyant encore à la concrétude de l’être.
En effet l’incarnation projette l’être dans le monde. Faisons ici une analogie théologique : les Évangiles disent que Dieu par le Christ s’est incarné. Or, avant la descente de Jésus sur la Terre, Dieu n’était qu’une abstraction contenue dans les prières. Par son incarnation dans le Christ, l’être de Dieu nous démontre que l’être soutient le tout, qu’il est « pantocrator », qu’il est omni tenens ; et donc que je ne peux pas posséder ce qui soutient le tout. A l’image de Gabriel Marcel dans « Être et avoir », lorsque je dis « j’ai un enfant », cela ne veut pas dire que je possède un enfant, que j’en suis le propriétaire. Cela est à comprendre de la manière suivante : je suis le père de cet enfant ou bien, cet individu est mon enfant. Il « est », et c’est parce qu’il est que je ne le possède pas. Effectivement l’être est libre, il a une existence propre qui découle de la chair, de son incarnation. Je le perçois comme mon fils car il est un être palpable, qui a son existence propre.
Enfin, c’est parce que tout ce qui est existe, que l’existant s’incarne, que l’être nous possède.
Pour conclure, de la chair, de l’incarnation Maurice Merleau-Ponty a fait de l’être un être vu et voyant percevant et perçu. Un être qui, grâce à la perception, se retrouve projeté dans le monde. Avec la philosophie de Merleau-Ponty, l’être se situe loin des circonvolutions heideggeriennes et de l’abstraction cartésienne. Ici nous avons affaire avec un être concret, pas seulement mis au monde mais mis dans le monde, faisant de lui un existant qui par l’intentionnalité de l’existence est un sujet dans l’intersubjectivité, dans la relation à l’autre.
L’être merleau-pontyen est de facto un être pour autrui, un être concret qui par un réseau relationnel et sensoriel habite le monde.
Florian Marek.
Bibliographie :
Maurice Merleau-Ponty, Signes, coll. Folio Essais, éd. Gallimard, 1960.
Gabriel Marcel, Être et avoir, éd. Aubier, 1935.
Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, éd. Gallimard, 1945.
Martin Heidegger, Être et Temps, trad. François Vezin coll. Tel, éd. Gallimard, 1968.
Maurice Merleau-Ponty, La structure du comportement, coll. Bibliothèque de philosopihe contemporaine, éd.
Presses Universitaires de France, 1942.
Maurice Merleau-Ponty, L’Oeil et l’Esprit, coll. Folilio Essais, éd. Gallimard, 1964.
Emmanuel de Saint Aubert, « Être et chair chez Merleau-Ponty », dans Ágora Filosófica, Recife (Brésil),
vol. 23, n° 3, septembre-décembre 2023, pp. 5-35.
https://www1.unicap.br/ojs/index.php/agora/article/view/2457/2226
Emmanuel de Saint Aubert, « “L’Incarnation change tout”. Merleau-Ponty critique de la “théologie
explicative” », in Archives de philosophie, tome 71, cahier 3, 2008, pp. 371-405.
https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2008-3-page-371.htm
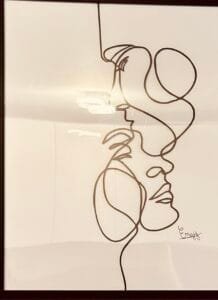



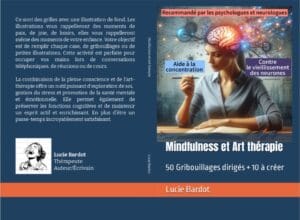

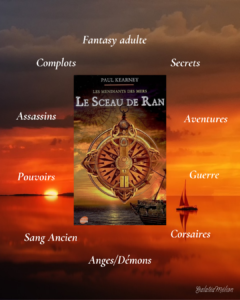

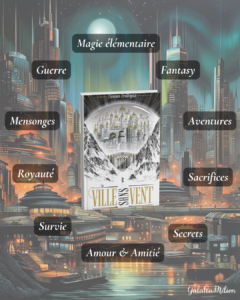


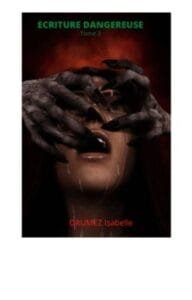

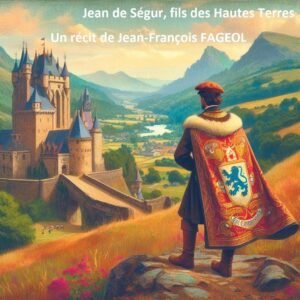



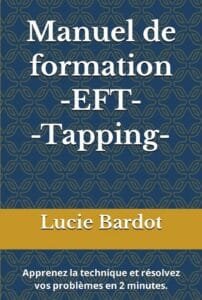
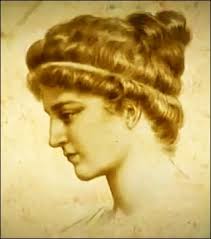
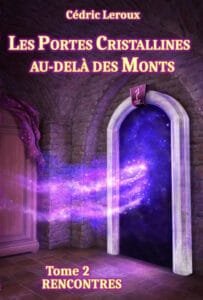
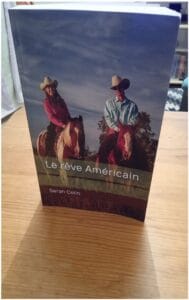

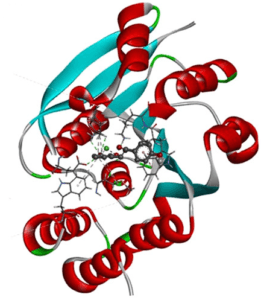
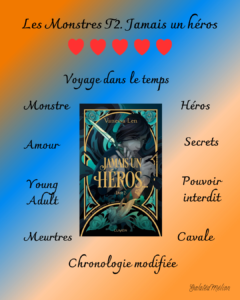
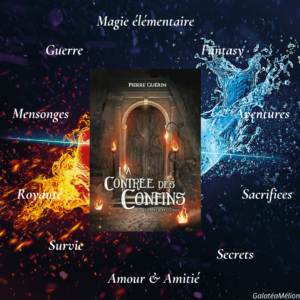
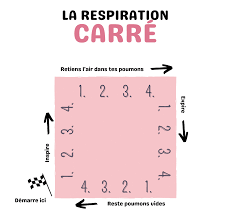
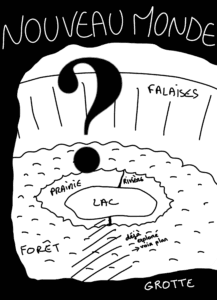
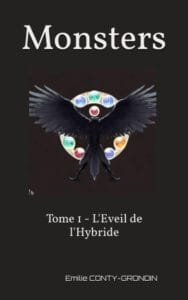

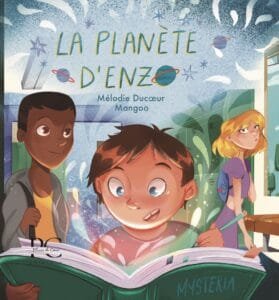
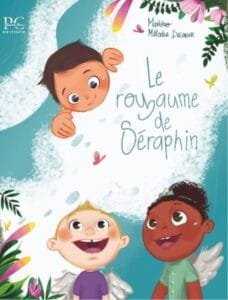
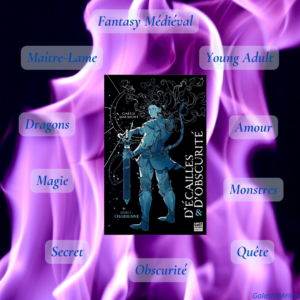

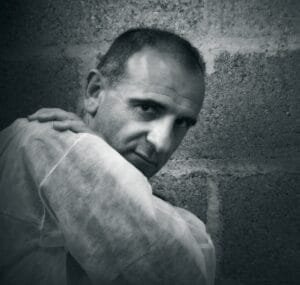

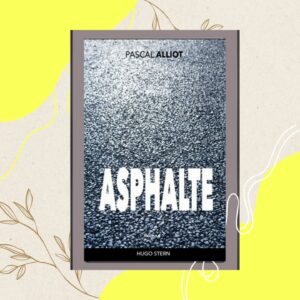




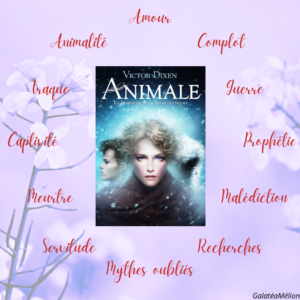
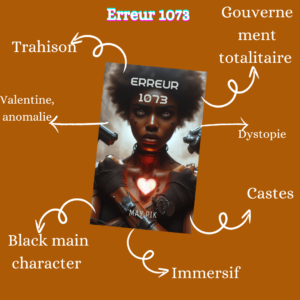



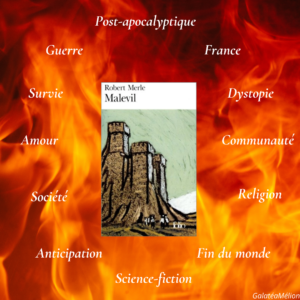

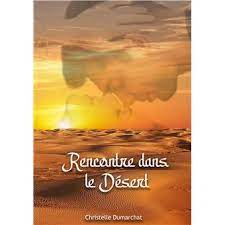

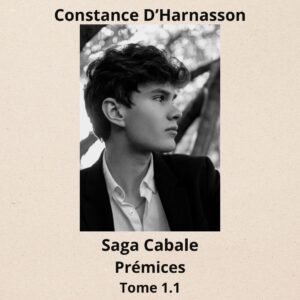



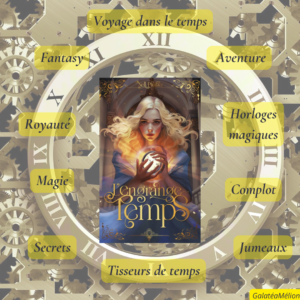

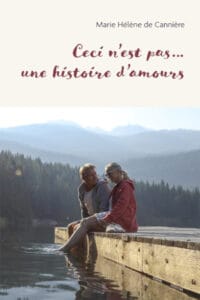


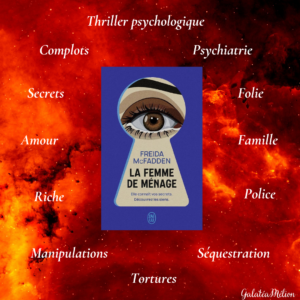
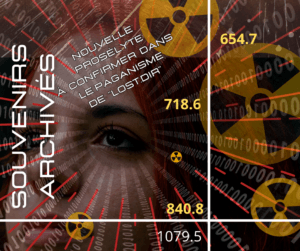



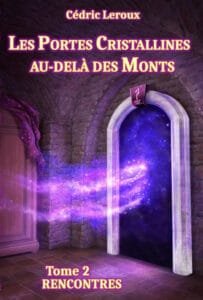

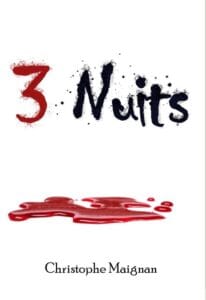
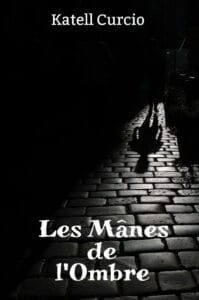
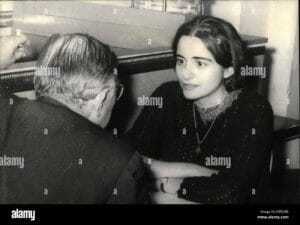

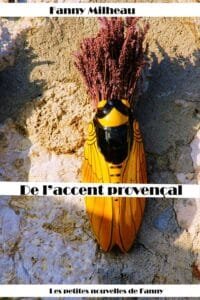
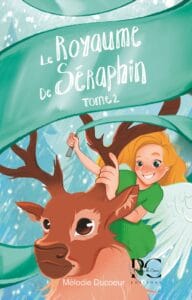

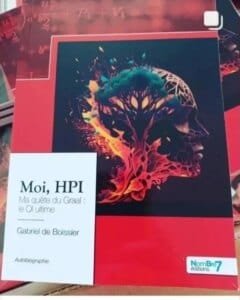

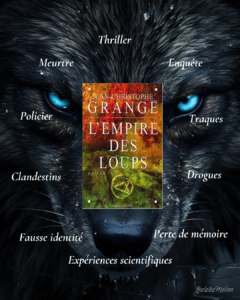




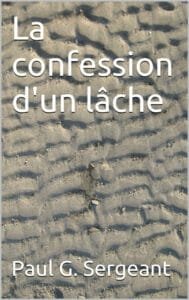
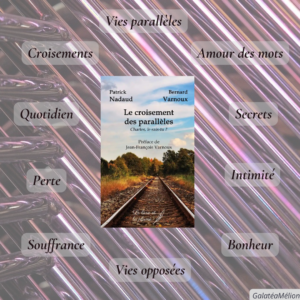
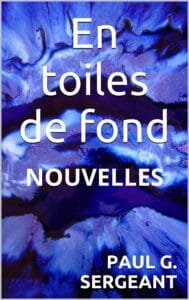
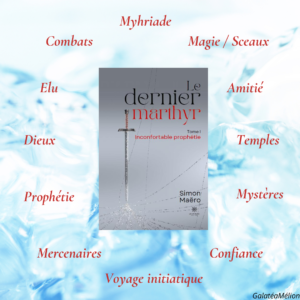
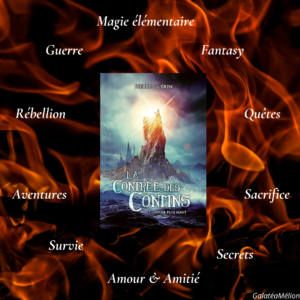
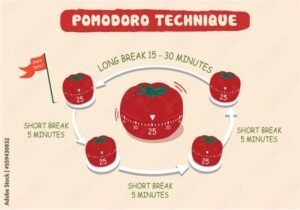


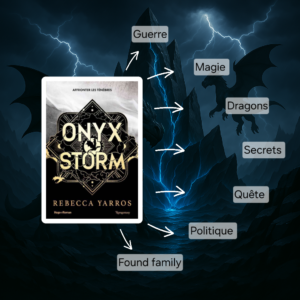





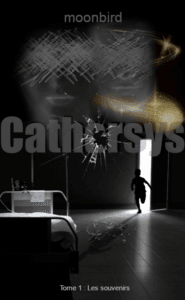

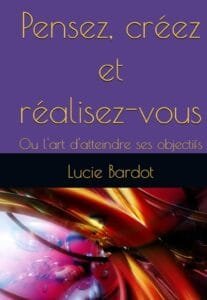

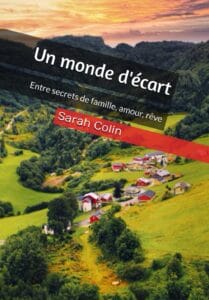
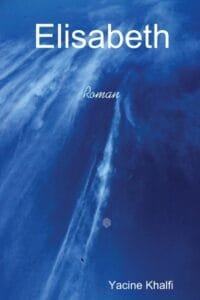




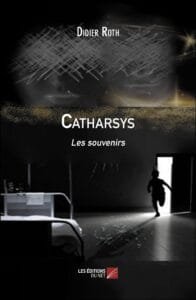
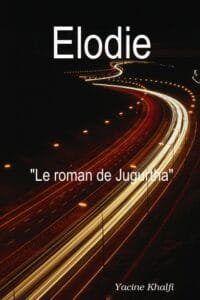
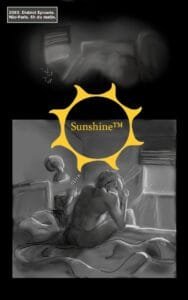






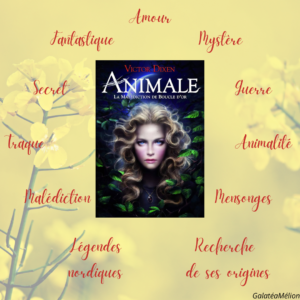

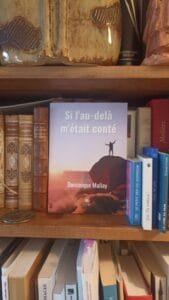

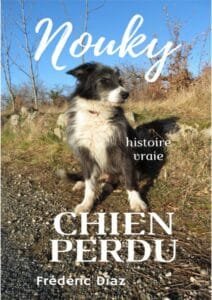

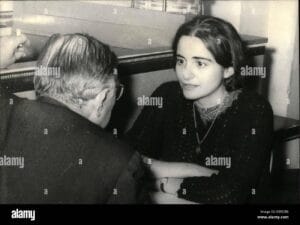
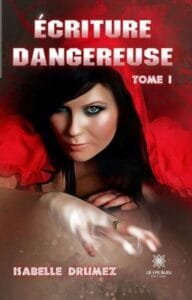

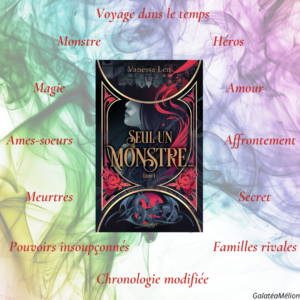


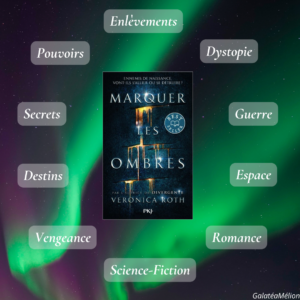
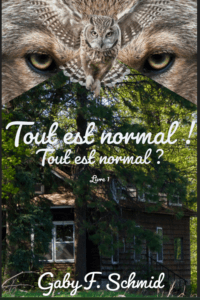
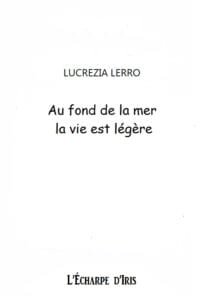
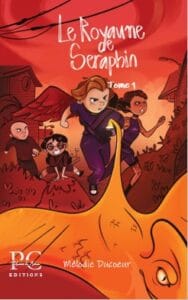
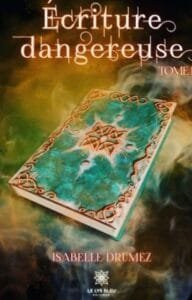
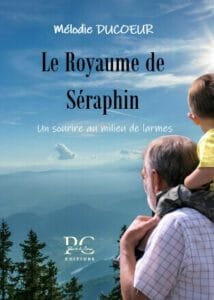
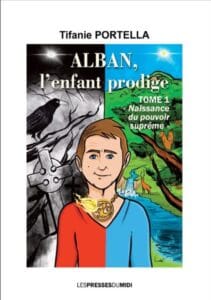


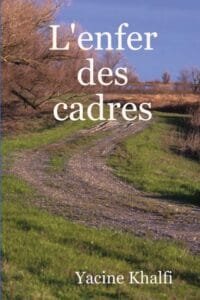


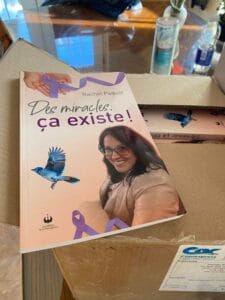

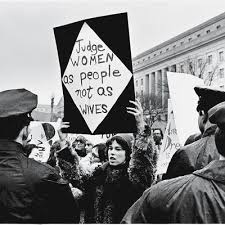

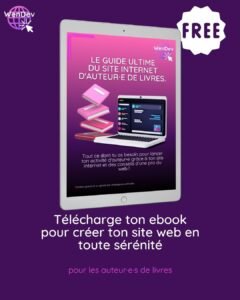
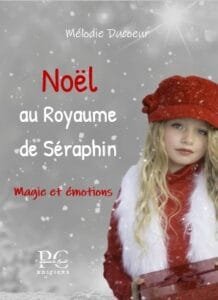
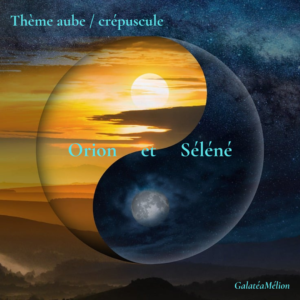
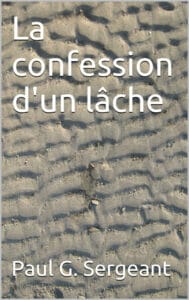
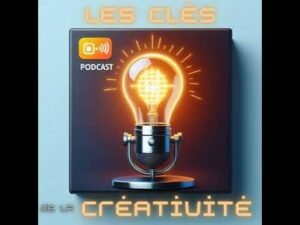
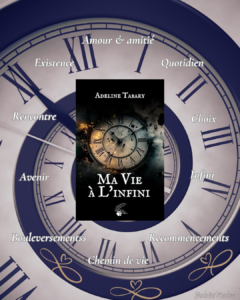



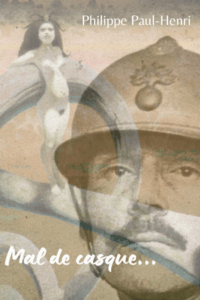
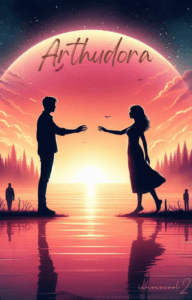



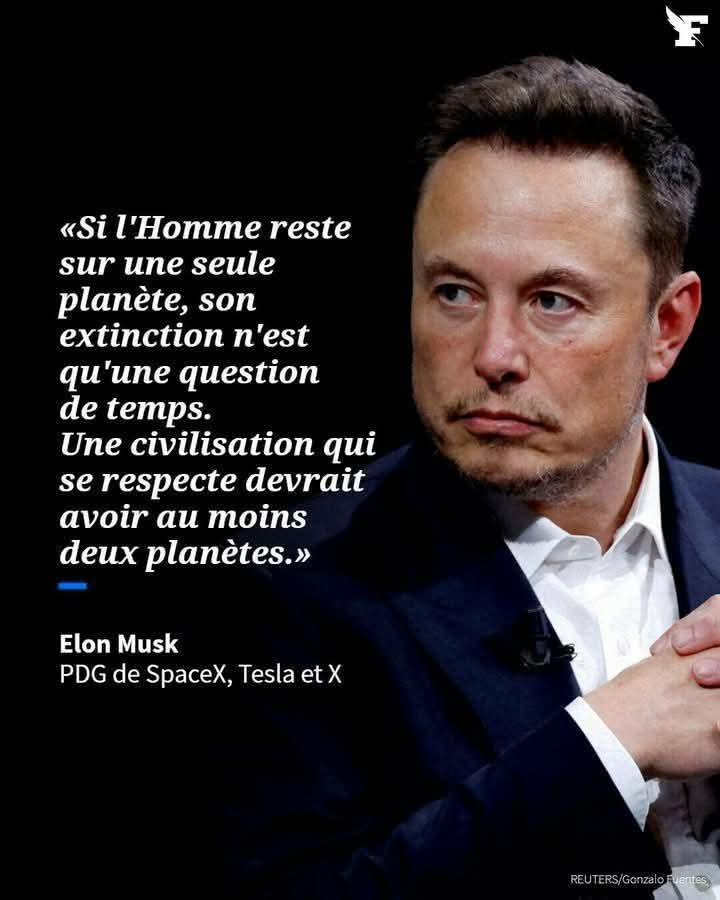
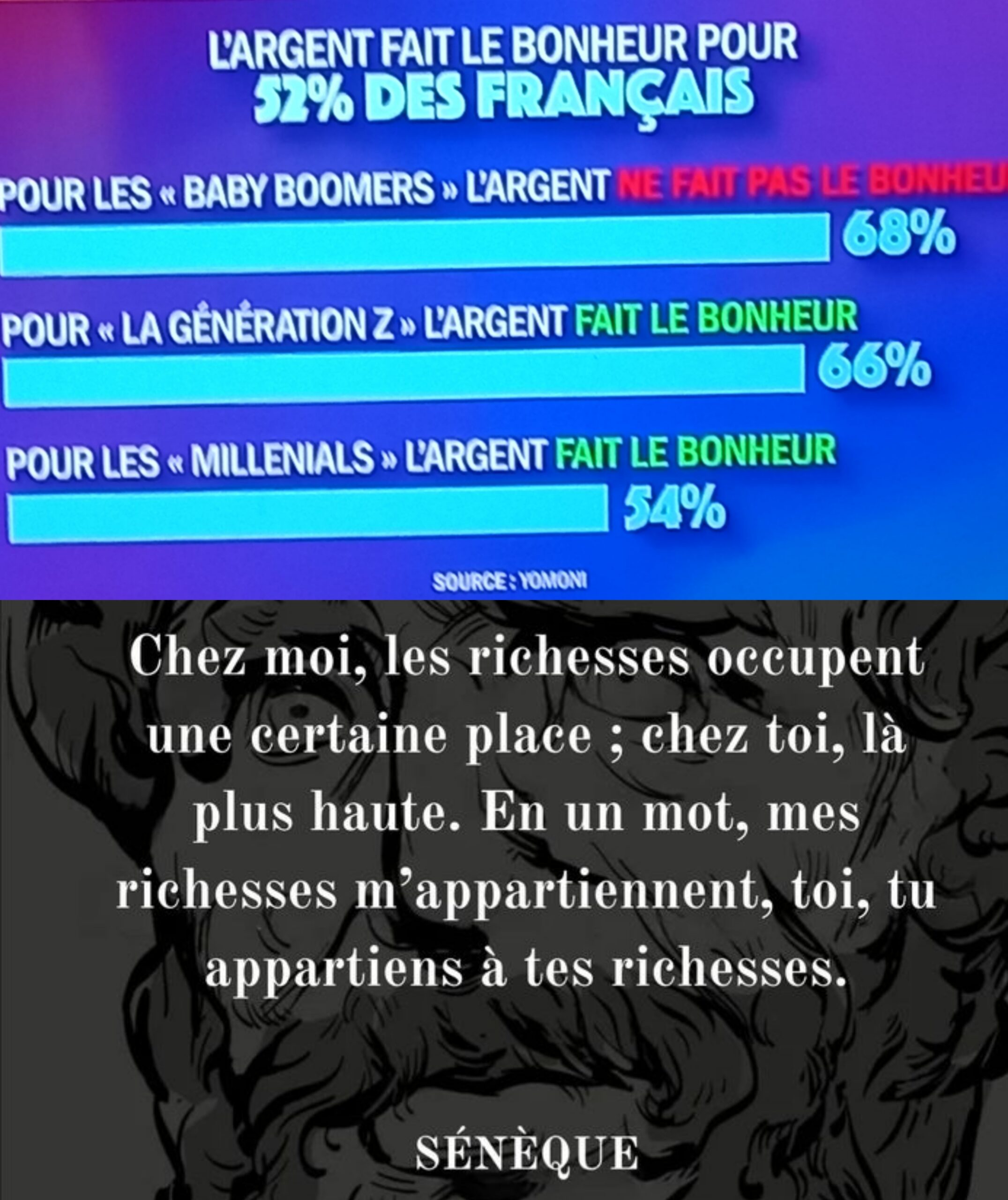
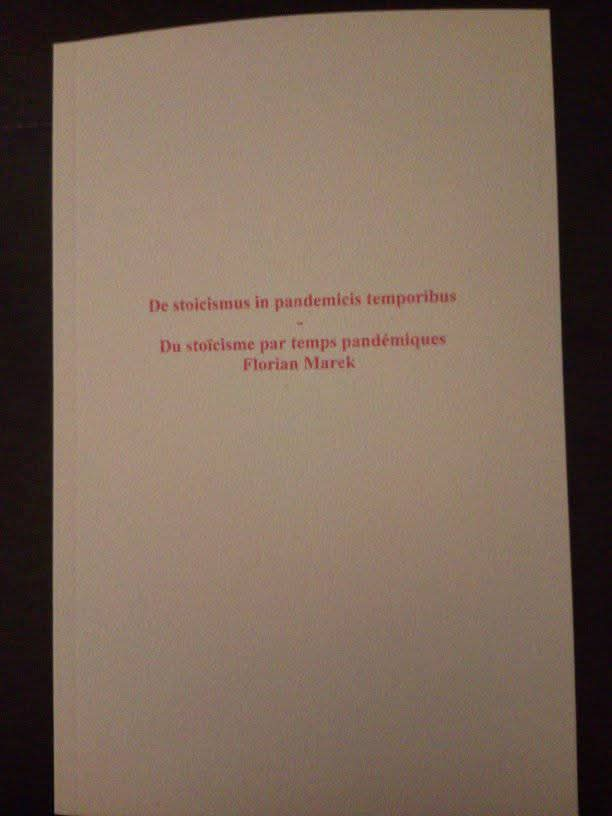



Commentaires (0)
Aucun commentaire pour le moment.